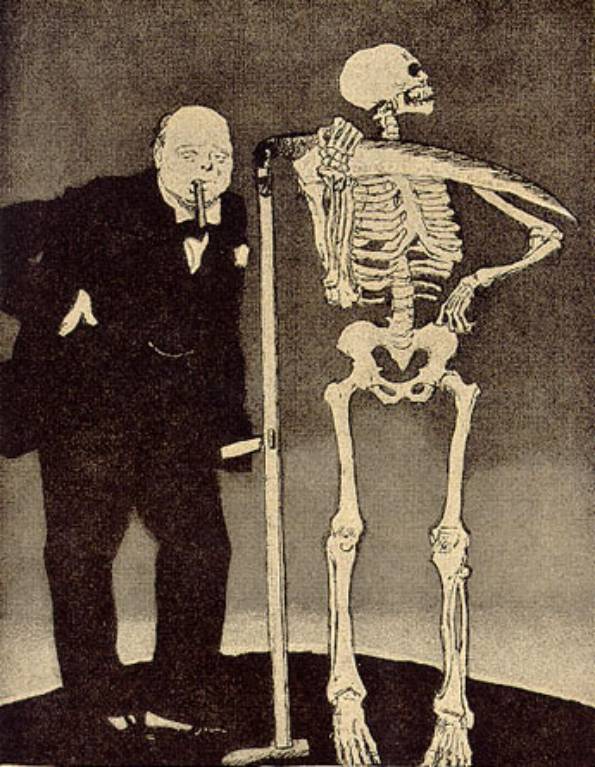
II. La caricature : un
art au service de la propagande
A.
La caricature dans la presse
Les
journaux, et notamment le Simplicissimus, journal satirique par
excellence, contiennent de nombreuses caricatures. Le dessin humoristique est
une forme d’expression autorisée par le régime nazi, à condition qu’elle
serve ses objectifs et qu’elle ne sorte pas du cadre étroit de ses
conceptions concernant la création et l’information. Incisive et réductrice,
la caricature associe une image simplifiée à un texte court. Elle se prête
donc à la conception de Goebbels dans le domaine de la manipulation des foules
: des images simples et fortes, compréhensibles par le plus grand nombre et
entraînant une émotion plutôt qu’une réflexion du public. Le dessin
humoristique, répond à cette exigence.
Le
régime nazi décide de maintenir une pluralité de titres dans le domaine de la
presse quotidienne et des revues pour répondre à deux exigences : offrir un
choix au lecteur, afin de ne pas le lasser et le convaincre, d’autre part,
qu’il subsiste dans le Reich une liberté d’expression et une libre
circulation de l’information. La présence de caricatures dans des journaux à
vocation satirique participe à cette entreprise de diversion. En effet, le
domaine de la création humoristique, par la liberté de ton et d’esprit
qu’il présuppose, est certainement le plus difficile à mettre au pas par un
régime totalitaire. Le tour de force consiste à l’intégrer pleinement au
vaste plan d’encadrement des esprits, à côté des autres vecteurs de la
propagande, tout en continuant à provoquer l’amusement du lecteur.
B.Le
but de la caricature
Mais ce rire doit être provoqué par des sujets bien définis et très limités. A la même époque, les caricaturistes américains et anglais n’hésitent pas à faire rire de sujets graves - la mort, les destructions matérielles, et même la déportation - afin de les dédramatiser, car en temps de guerre, la population souffre, et le rire devient une libération. En revanche, à aucun moment, le dessin humoristique allemand ne s’amuse du régime, de la population allemande, ou des soldats de la Wermacht, alors que les dirigeants et les soldats alliés sont largement mis en scène par la caricature anglo-saxonne. Le totalitarisme nazi ne souffre ni l’ironie, ni l’auto-dérision. Les lecteurs allemands peuvent rire, mais aux dépens de l’ennemi exclusivement.
La
représentation de l’ennemi par les dessins humoristiques répond à des critères
bien précis. La caricature tient une place à part dans un journal ou un
magazine : on la remarque du premier coup d’oeil, avant d’entreprendre la
lecture des articles. Bien souvent, c’est le seul élément du journal qui
tombe sous les yeux des enfants, des adolescents et de la femme au foyer. Elle
doit donc être compréhensible et lisible par tous, c’est la condition de son
efficacité. De ce fait, les pays ennemis sont symbolisés de façon à être
immédiatement identifiés et ce, le plus souvent, par le biais de leurs
dirigeants : Daladier, Chamberlain et Churchill, puis Staline et Roosevelt sont
mis en scène.
La
représentation ne doit pas laisser place au doute :
Churchill est muni de son parapluie et de son cigare sur lesquels son
nom ou ses initiales (WC) sont fréquemment inscrits afin de pallier la déformation
de la caricature.
Staline, enfin, est aisément identifiable grâce à la moustache,
aux grosses bottes cloutées et parfois au célèbre knout(fouet).
Roosevelt apparaît
rarement sans sa canne - ici, le signe distinctif est également un sujet de
moquerie.
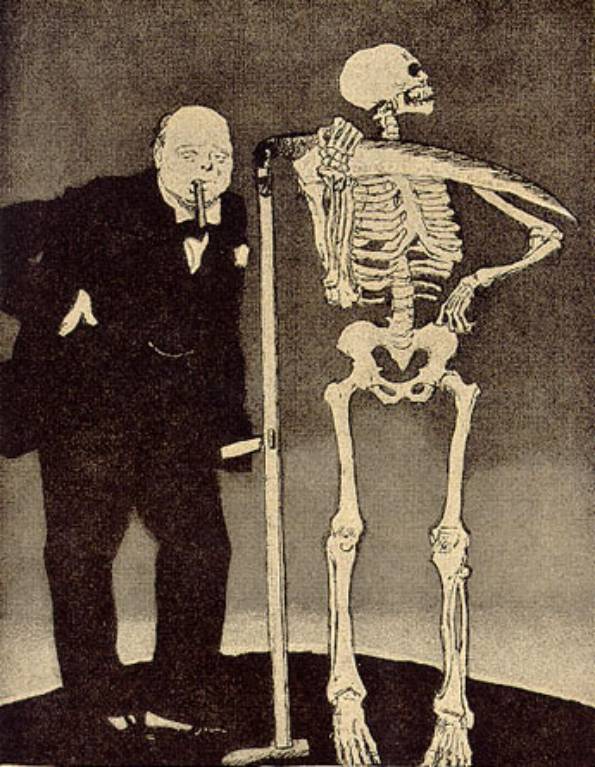
"Keep it up, Mr. Churchill, and we'll soon be doing business
together.”
Source:
Simplicissimus, 6 Août 1939
Lorsque le chef d’état
n’apparaît pas, le pays est symbolisé par un élément caractéristique :
§
l’Angleterre est représentée
par le lion sur lequel figure l’" Union Jack ", le
soldat anglais, reconnaissable à la forme particulière de son casque, le
personnage-symbole de " John Bull ", ou par le roi - la couronne et le
trône sont dessinés...
§
L’URSS est représentée par
le soldat bolchevique - l’étoile rouge et l’uniforme sont là pour
faciliter la reconnaissance.
§
L’Amérique, c’est le cow-boy ou l’" Oncle Sam
". Une ébauche de décor permet d’identifier les champs de bataille :
falaises de l’Angleterre, neiges de Sibérie, palmiers du Pacifique ou ruines
antiques de l’Italie.
Les
modes de représentation ne sont donc guère originaux. Ils véhiculent des
images classiques et très réductrices des puissances ennemies. Le capitalisme
international, thème récurrent dans les caricatures, est symbolisé comme
partout ailleurs par un gros bourgeois en habits, coiffé d’un haut de forme,
marqué du symbole du dollar ($) ou de la livre (£). Ces images sont le plus
souvent négatives. Dans la période de guerre, la propagande se donne pour tâche
d’accentuer ces traits afin de mieux dénoncer l’ennemi. On peut relever une
différence importante avec la propagande artistique : la caricature est le seul
domaine à échapper à l’obligation d’une représentation figurative, seul
mode de représentation autorisé par le régime, le réalisme
national-socialiste, en quelque sorte. L’objectif des caricatures n’est pas
d’enjoliver ou d’exalter tel ou tel aspect du régime ou du peuple, mais de
dénoncer l’ennemi.
L’artiste
peut faire " laid ", puisqu’il s’agit de dénoncer ce qui est laid
aux yeux de la doctrine officielle.
Derrière le personnage, qui
est le plus souvent la cible directe du dessin, il existe un arrière-plan idéologique.
Un dessin représentant Churchill provoque d’instinct une aversion de par les a
priori inculqués au lecteur grâce aux autres moyens de la propagande, mais
également grâce aux éléments complémentaires introduits dans le dessin, ou
encore grâce au texte. Cet arrière-plan est le plus souvent simple, il dépasse
rarement le premier degré. Mais il fait directement appel à des valeurs familières
au lecteur.
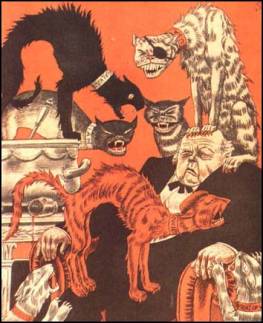
Erich
Schilling, Winston
Churchill,
(Simplicissimus, 1er Janvier 1942)